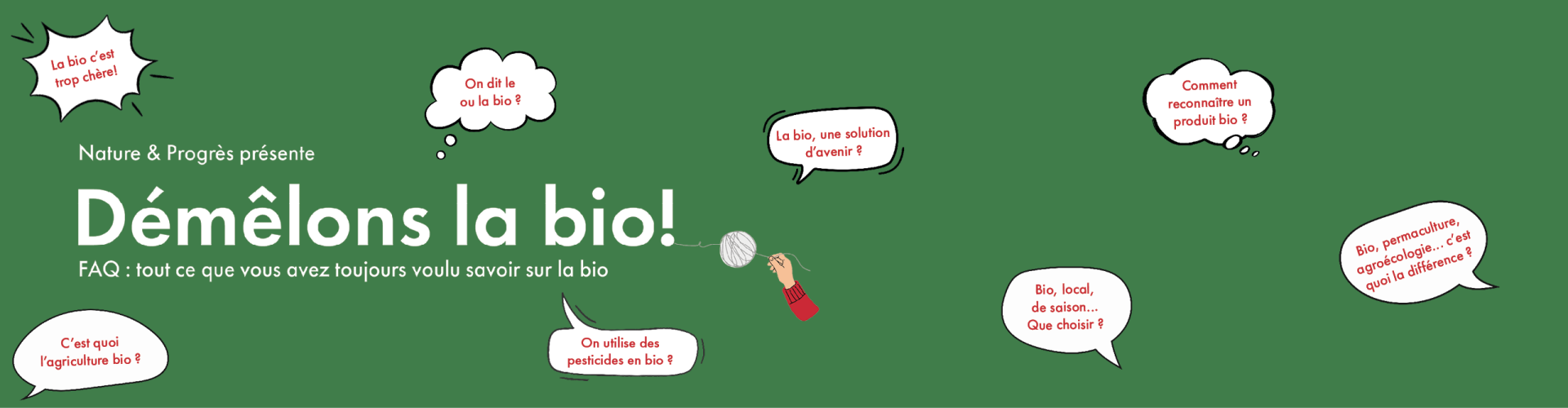
« La bio c’est trop chère! » – « On dit le ou la bio ? » – « Comment reconnaitre un produit bio ? » – « Bio, local, de saison… que choisir ? »
Nature & Progrès Belgique présente « Démêlons la bio! » une FAQ qui vous dit tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la bio.
Comment reconnaître un produit bio ?
Le logo européen « eurofeuille » garantit que le produit est certifié biologique. C’est un rectangle vert avec des étoiles blanches formant une feuille.
Attention à ne pas confondre le logo européen avec le logo « AB », une marque française gérée par le Ministère de l’Agriculture. Le logo « AB » peut aussi se retrouver sur des produits qui respectent un règlement spécifique en France. En Belgique, le label Biogarantie est l’équivalent de l’AB français : https://biogarantie.be/ .
La mention « Nature & Progrès » peut s’ajouter à l’eurofeuille pour souligner l’engagement éthique au niveau des conditions de production et de transformation, au-delà de la simple certification bio : https://www.natpro.be/producteurs-bio-natpro/nos-producteurs/.
Comment se déroule la certification bio ?
Toute personne souhaitant produire, transformer ou vendre des produits bio doit être contrôlée par un organisme indépendant. En Belgique, il y a cinq organismes de contrôle accrédités par BELAC (Service Public Fédéral Économie). Les contrôles sont réalisés tout au long de la chaîne alimentaire et peuvent être inopinés (par exemple, prélèvements pour analyses) ou sur rendez-vous pour vérifier les aspects administratifs (origine des ingrédients, étiquetage…).
- Que se passe-t-il en cas d’infractions ? En cas de non-respect des règles, une grille de sanctions est appliquée. Cela peut aller d’un simple avertissement à une interdiction totale de vendre les produits sous le label bio. Les organismes de contrôle délivrent un certificat annuel aux opérateurs respectant les normes bio.
- Où trouver la liste des acteurs et des actrices du bio ? L’annuaire de Biowallonie rassemble les opérateurs de la production, de la transformation, de la distribution, ainsi que les points de vente et les lieux de restauration certifiés bio : https://www.biowallonie.com/acteursbio.
Qu’est-ce que l’agriculture biologique ?
L’agriculture biologique est un modèle agricole certifié, encadré par une réglementation européenne stricte, le Règlement (UE) 2018/848. Cette réglementation régit la production, la transformation et la vente des produits bio, ainsi que leur étiquetage. Seuls les produits respectant ces règles peuvent utiliser les termes « bio » ou « biologique ».
Pour plus de détails, une version simplifiée de la législation est disponible sur le site de Biowallonie : www.biowallonie.com/reglementation.
Quelles sont les garanties de l’agriculture biologique ?
- Production végétale : Les cultures bio n’utilisent pas de pesticides ni d’engrais chimiques. Seuls des produits naturels, figurant sur une liste autorisée, peuvent être employés pour protéger les plantes. Les cultures sont également garanties sans OGM et doivent utiliser des semences bio, sauf rares exceptions. Des dérogations sont en effet possibles dans le cas d’espèces et variétés non disponibles en bio. Dans ce cas, l’agriculteur peut avoir recours à des semences et des plants conventionnels, mais non traités. La production hors-sol est interdite.
- Production animale : Les animaux en élevage bio sont nourris avec des aliments bio et sans OGM. Les traitements médicaux chimiques (antibiotiques) sont limités aux cas de nécessité absolue. Dans ce cas, les périodes d’attente avant la commercialisation des produits animaux sont doublées pour éviter tout résidu. Le bien-être animal est aussi pris en compte : les animaux doivent avoir accès à l’extérieur et disposent de davantage d’espace. L’élevage « hors-sol » est formellement interdit.
- Transformation des produits : Les additifs chimiques, tels que les colorants et conservateurs, sont interdits dans la transformation des produits bio. Seuls des ingrédients naturels, mentionnés sur une liste positive, peuvent être utilisés. Les produits transformés bio doivent contenir au moins 95 % d’ingrédients bio. Pourquoi pas 100 % ? Parce que certains ingrédients ne peuvent pas être produits, ou difficilement, en bio. Il s’agit par exemple du sel, de certains ferments et levures ou encore de certaines épices qui ne seraient pas disponibles en bio.
Les ingrédients ne peuvent pas être irradiés, c’est-à-dire qu’ils ne peuvent pas être exposés à des rayonnements ionisants. Ce procédé vise généralement à détruire des bactéries, ralentir la germination ou prolonger la durée de conservation. Mais il détruit les vitamines et les nutriments essentiels.
Est-ce que le bio garantit une alimentation parfaitement saine ?
Pas forcément. Le label bio assure le respect du cahier des charges au niveau européen, qui apporte une série de garanties au niveau environnemental, contrôlées par des organismes indépendants. Mais le label bio ne garantit pas pour autant que les produits soient diététiques, ni végans, sans gluten, ou encore locaux, d’ailleurs.
Pour des produits qui vont plus loin que le cahier des charges bio, il existe des mentions comme « Nature & Progrès ». Une charte rassemble producteur.trice.s, transformateur.trice.s et consommateur.trice.s autour de valeurs communes fortes et fondatrices, qui complètent la réglementation européenne en intégrant des dimensions relatives au respect de l’environnement, à la justice sociale et à la solidarité économique.
La bio est-elle accessible ? Quelles solutions pour les publics défavorisés ?
L’argument du prix est souvent utilisé pour associer la bio à un privilège réservé aux classes aisées. Mais est-ce réellement une fatalité ? Si l’on regarde au-delà des idées reçues, l’agriculture biologique peut être une réponse aux difficultés économiques plutôt qu’un facteur d’exclusion.
Une alternative au modèle dominant
Le système actuel favorise la grande distribution et l’agriculture intensive, souvent au détriment des populations les plus précaires. Beaucoup de foyers en difficulté sont contraints de se tourner vers le hard discount et l’aide alimentaire, où la qualité nutritionnelle passe au second plan. Des alternatives qui concilient alimentation saine et accessibilité existent.
Produire et consommer autrement
L’accès au bio ne se limite pas au prix affiché en rayon. Il repose aussi sur une réorganisation de la production et de la consommation. Plusieurs initiatives montrent qu’il est possible d’obtenir des aliments bio à moindre coût en s’impliquant dans des systèmes collectifs :
- Les potagers partagés et jardins nourriciers, où chacun contribue à la production alimentaire.
- L’auto-cueillette en maraîchage, qui réduit les coûts en supprimant une partie du travail de récolte.
- Les coopératives alimentaires, qui permettent d’acheter en direct, en limitant les marges des intermédiaires.
- Les groupements d’achat, qui donnent accès à des prix plus avantageux par l’achat en gros. Avec entre autre l’initiative « mini pousses » qui distribue des panier bio gratuits pour les femmes enceintes à récupérer dans un point de distribution Agricovert
Ces solutions favorisent réellement une alimentation bio et locale tout en renforçant le lien social. Ceci dit, elles ne suffisent pas à lever tous les obstacles : l’accès à une alimentation de qualité dépend encore largement du lieu de vie, des moyens de transport, du temps disponible et du statut social.
Des dispositifs comme la Sécurité Sociale de l’Alimentation (SSA) sont envisagés pour garantir l’accès équitable à une nourriture de qualité. Loin d’être un luxe réservé à une élite, l’agriculture biologique peut devenir un levier de justice sociale. Encore faut-il repenser notre approche, valoriser les solutions locales, solidaires et inclusives.
Pour en savoir plus, voir le site du Collectif de réflexion et d’action sur une Sécurité Sociale de l’Alimentation (CréaSSA) : https://www.collectif-ssa.be/ .
Faut-il vraiment manger moins de viande ?
L’agriculture biologique ne dicte pas de règles strictes concernant la consommation de viande, mais il existe plusieurs raisons pour en consommer de manière raisonnée. Les principaux arguments sont liés à la santé, à l’environnement et au bien-être animal.
Le bien-être animal en agriculture biologique
En bio, les animaux bénéficient de meilleures conditions de vie. Ils ont accès à l’extérieur et disposent de davantage d’espace. De nombreux producteurs vont au-delà de ces exigences, notamment dans les circuits courts ou encore dans la mention Nature & Progrès. La charte éthique de Nature & Progrès prévoit en effet l’optimisation des conditions de vie et le respect de l’éthologie des animaux élevés.
L’élevage et l’agriculture biologique
L’agriculture biologique, selon Nature & Progrès, a besoin d’élevage pour être complète. L’élevage permet d’entretenir les sols avec du fumier ou encore de valoriser des milieux difficilement cultivables. Toutefois, la consommation actuelle de viande reste excessive. Il est conseillé de diversifier les sources de protéines avec différentes légumineuses.
L’impact environnemental
L’impact environnemental de la production de viande dépend fortement du modèle d’élevage. Ainsi, les ruminants élevés à l’herbe sur des prairies entretiennent aussi ces espaces, qui peuvent alors compenser les gaz à effet de serre émis.
Réduire la consommation de viande, notamment transformée, et privilégier la viande bio locale est donc une approche équilibrée pour notre santé et l’environnement.
Pourquoi faire le choix de l’autonomie ?
Dans notre vie quotidienne, nous sommes souvent dépendants de facteurs que nous ne contrôlons plus. L’autonomie, ce n’est pas tout faire soi-même, mais conserver une véritable liberté de choix, notamment sur des aspects essentiels comme l’alimentation, l’énergie, le logement et la mobilité. Cela signifie ne pas se contenter des options imposées par le marché, mais choisir ce qui a du sens pour nous.
Autonomie vs Autosuffisance
Être autonome ne signifie pas être autosuffisant, c’est-à-dire ne dépendre de personne. L’autosuffisance totale, comme produire toute sa nourriture, est difficilement réalisable, même à l’échelle d’un pays. L’autonomie, c’est plutôt avoir le pouvoir de prendre ses propres décisions, surtout au niveau local, en matière de production et de consommation.
La notion de « souveraineté alimentaire » permet à un pays de définir ses propres politiques agricoles sans nuire à d’autres pays. L’autonomie locale, appliquée à des familles ou des communautés, c’est décider ensemble des méthodes de production alimentaire les plus justes.
Quelle est la différence entre le bio et d'autres modes de production comme la permaculture ou l'agroécologie ?
Contrairement à l’agriculture biologique, des pratiques comme la permaculture ou l’agroécologie ne sont pas définies par une réglementation européenne et ne font pas l’objet de contrôles certifiés indépendants. Cela signifie que n’importe qui peut se revendiquer de ces pratiques, alors que le bio doit respecter un cahier des charges précis et contrôlé, ce qui offre des garanties fiables aux consommateurs.
- Pourquoi la bio est-elle plus qu’un simple remplacement de produits chimiques par des produits naturels ? L’agriculture biologique ne se limite pas à remplacer des produits par d’autres. Elle s’attache à rendre les exploitations plus autonomes et adaptées à leur environnement (climat, sol, biodiversité…). Par exemple, les agriculteurs bio cherchent à renforcer la fertilité de leur sol en utilisant des matières organiques, en évitant les labours profonds et en diversifiant leurs cultures. Les éleveurs, eux, travaillent dans le respect du bien-être animal et privilégient des races adaptées à leur environnement.
Utilise-t-on des pesticides en agriculture biologique ?
L’agriculture biologique est parfois réduite à l’idée d’une agriculture « sans pesticides », mais cette vision simpliste ne reflète pas toute la réalité. En effet, les pesticides et engrais chimiques de synthèse ainsi que les Organismes Génétiquement Modifiés (OGM) sont strictement interdits en bio. Cette interdiction découle du principe fondamental de la bio : stimuler la vie du sol pour garantir la santé des plantes, d’où le célèbre adage « Prendre soin du sol qui prendra soin des plantes ».
La bio s’appuie sur des pratiques qui favorisent la vigueur des plantes et limitent les perturbations du sol : désherbage mécanique, réduction des labours, rotations longues de cultures, compostage, association de cultures, choix de variétés résistantes, entre autres. Ces méthodes visent à prévenir de manière naturelle les maladies et les parasites.
Les biopesticides, une utilisation limitée et encadrée. Cependant, l’utilisation de certains produits d’origine naturelle, appelés « biopesticides », est tolérée en bio. Leur usage reste une solution de dernier recours, souvent curative, lorsqu’il n’a pas été possible de prévenir les problèmes autrement. Par exemple, le cuivre peut être utilisé de manière préventive contre le mildiou, mais seulement si les conditions climatiques propices à la maladie sont réunies (chaleur et humidité). Avant de recourir au cuivre, les agriculteurs bio privilégient la prévention par le choix de variétés résistantes, l’espacement des plantations et l’aération des cultures.
En Europe, 41 matières actives sont autorisées en bio, et 10 d’entre elles ont une toxicité identifiée. En conventionnelle, ce sont 385 matières actives qui sont autorisées, et 340 d’entres elles ont une toxicité identifiée. 27 matières actives autorisées en conventionnel sont suspectées d’être cancérigène, contre aucune en bio. Ces informations proviennent du guide « Démystifier le bio » de Biowallonie : https://www.biowallonie.com/nouveau-guide-demystifier-le-bio/ .
Pour en savoir plus :
- www.biowallonie.com/reglementation/producteurs/
- Fytoweb pour consulter la liste des produits phytopharmaceutiques autorisés en agriculture biologique en Belgique.
- https://itab.bio/thematique-en-bref/la-sante-quantification-des-externalites-de-lagriculture-biologique
La bio est-elle agroécologique ?
Aujourd’hui, le terme agroécologie désigne un ensemble de pratiques agricoles favorables à l’environnement. Il regroupe à la fois des recherches scientifiques, des initiatives locales et des mouvements sociaux à travers le monde. L’objectif est d’adapter les méthodes agricoles aux spécificités de chaque territoire tout en préservant les écosystèmes.
L’agriculture biologique s’inscrit pleinement dans cette démarche et en constitue même l’une des formes les plus abouties. Toutefois, toutes les approches dites « agroécologiques » ne respectent pas forcément les principes de la bio. Certaines méthodes, comme l’agriculture de conservation des sols (ACS), intègrent encore l’usage d’herbicides controversés, dont le glyphosate, pour limiter le travail du sol.
Doit-on dire "le" bio ou "la" bio ?
On entend souvent parler du bio ou de la bio. Y a-t-il une vraie différence ? En réalité, ces deux usages reflètent des visions distinctes de l’agriculture biologique.
- « Le bio » (au masculin) fait référence au marché, à la consommation et à l’offre de produits biologiques dans les circuits de distribution. C’est une approche qui s’intéresse à la disponibilité et à l’accessibilité des aliments bio pour les consommateurs.
- « La bio » (au féminin) évoque avant tout une démarche agricole, un projet de société centré sur la préservation de la terre et de notre santé. C’est une vision qui met en avant des valeurs écologiques et éthiques, en lien avec une agriculture respectueuse du vivant sous toutes ses formes.
Cette distinction met en lumière un débat de fond : l’agriculture biologique doit-elle s’adapter aux contraintes du marché ou rester fidèle à ses principes fondateurs ? Cette question rejoint aussi des réflexions plus larges sur le rôle des femmes dans l’agriculture et sur l’écoféminisme, qui défend une approche plus équilibrée et durable du rapport entre l’humain et la nature.
La bio est-elle plus chère que le conventionnel ?
Le prix est souvent le premier argument avancé contre la consommation de produits bio. Dans un contexte où la précarité augmente, cette question est essentielle. Pourtant, si on tient compte des externalités négatives de l’agriculture conventionnelle et de leurs coûts pour la société, la réalité est plus nuancée.
Un coût global de la bio plus économique
Si l’on privilégie les produits bruts, de saison et locaux, on peut réduire son budget alimentaire. Cuisiner davantage et limiter les produits transformés permet aussi de faire des économies. Mais cela ne répond pas à la vraie question : pourquoi le bio coûte-t-il plus cher à l’achat ?
L’agriculture conventionnelle bénéficie de nombreux soutiens publics et cache des coûts indirects : pollution, impact sur la santé, destruction des sols… Ces coûts sont finalement payés par la société sous d’autres formes (soins médicaux, dépollution). En prenant en compte l’ensemble de ces facteurs, le bio pourrait être considéré comme plus économique à long terme.
Le coût de la certification bio
Les producteurs bio doivent payer pour prouver la qualité de leurs pratiques, contrairement aux exploitations conventionnelles qui ne sont pas taxées pour leur impact négatif. Le coût de la certification est variable selon l’organisme de certification et la situation (type d’activité, chiffre d’affaires, etc).
Pour en savoir plus :
- Le livret explicatif de Biowallonie sur la certification pour les agriculteurs et les agricultrices : Livret-Certification_Productions-primaires-10-decembre-2024.pdf
- Le livret explicatif de Biowallonie sur la certification pour les transformateurs, distributeurs, importateurs, points de vente et restaurateurs : Microsoft Word – Livret Certification transformateurs et autres – 22 avril 2025 – Copie
Une question de politique agricole
Le soutien aux grandes exploitations, via la Politique Agricole Commune (PAC) favorise encore aujourd’hui l’agriculture conventionnelle intensive. De plus, la bio privilégie des pratiques plus extensives, avec plus de main-d’œuvre et moins de productivité immédiate, ce qui peut aussi influencer les prix.
L’importance des circuits courts
Acheter en direct auprès des producteur.trice.s ou via des circuits courts réduit les intermédiaires et permet souvent d’obtenir des prix plus abordables. À l’inverse, la grande distribution applique souvent des marges plus importantes sur le bio, ce qui augmente le prix pour le consommateur.
Enfin, adopter une consommation plus responsable (achat en vrac, réduction des emballages, choix de produits locaux et peu transformés) peut aider à optimiser son budget tout en respectant une démarche écologique.
Pour en savoir plus :
- Aubert C., Mayer Mustin C., Mustin M. et Lairon D., L’agriculture biologique malmenée, 10 mythes à déconstruire, sur generations-futures.fr
- https://jepasseauvrac.be/observatoire-bio-vrac/
- « Démystifier le bio » par Biowallonie https://www.biowallonie.com/nouveau-guide-demystifier-le-bio/
La bio en grandes surfaces, est-ce bien, ou pas ?
L’idée de la consommation bio en grandes surfaces soulève de nombreuses questions, souvent contradictoires. Bien que la vente de produits biologiques dans ces enseignes ait permis une certaine démocratisation de l’agriculture biologique, elle a également amené à une certaine « industrialisation » de la bio. Dès ses débuts, certains acteurs commerciaux ont vu dans le bio un créneau lucratif à exploiter, avec des consommateurs prêts à payer plus cher pour avoir l’impression de faire un choix plus éthique ou plus sain. Cependant, la question se pose : est-ce que cette présence du bio en grandes surfaces respecte réellement les principes fondamentaux de la bio ?
Un décalage avec l’esprit de la bio
Il est important de souligner que la consommation de produits bio ne se limite pas à leur présence dans les rayons des grandes surfaces. Beaucoup de personnes associent « bio » à « bio en grandes surfaces ». Cela peut donner une fausse image de ce qu’est réellement l’agriculture biologique. Le bio en grande surface tend à se conformer à une logique de consommation de masse, là où le prix et le volume priment sur les valeurs fondatrices du bio. Comme l’explique Daniel Cauchy dans Valériane n°81, des produits comme une simple tartelette aux cerises vendue en grande surface, bien qu’elle soit étiquetée comme bio, dissimule souvent un réseau complexe et polluant de transport, et d’exploitation, loin des principes du circuit court ou des producteurs bio locaux.
Le problème du « bio industriel »
L’un des principaux reproches au bio en grandes surfaces, c’est sa transformation en « bio industriel ». Ce phénomène permet certes de remplir les rayons des supermarchés avec des produits étiquetés comme bio, mais ces produits sont souvent issus d’une production à grande échelle. Cela va à l’encontre de l’esprit originel de la bio qui prône des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement et de l’humain. Le bio en grandes surfaces est souvent porté par un système technologique et énergétique coûteux et polluant. Comme le souligne Daniel Cauchy, ces produits sont souvent issus de chaînes de production qui exploitent à la fois les travailleurs et l’environnement. Cela nous rappelle que la cerise, par exemple, n’est pas simplement une cerise : selon son origine et sa méthode de culture, elle peut être le fruit de conditions de travail quasi-esclavagistes dans des pays comme l’Espagne ou la Hongrie, avant même d’atteindre nos étagères.
Circuit court vs grande distribution
La grande distribution, avec son modèle basé sur la maximisation des profits, cherche constamment à écraser les prix, ce qui peut mener à des marges de plus en plus faibles pour les producteurs. En revanche, les circuits courts, défendus par des acteurs comme Nature & Progrès, reposent sur des relations plus transparentes et équilibrées entre producteurs et consommateurs. Ces producteurs fixent leurs prix de manière juste pour assurer leur rentabilité, tout en s’efforçant de maintenir un prix acceptable pour les consommateurs. C’est un modèle économique plus transparent, qui repose sur une logique de prix juste, et non sur la spéculation ou l’écrasement des coûts. Il met en avant des produits de qualité, dans une dynamique respectueuse des humains et de la planète.
La bio en grande surface n’est pas nécessairement une mauvaise chose, mais elle pose la question de la véritable éthique derrière cette production. Le bio en circuit court, porté par des petites structures locales, est plus en phase avec les valeurs de la bio authentique. Il est donc important d’avoir conscience de la distinction entre « bio industriel » et « bio local ».
Bio, local, de saison... Quelles priorités pour ma consommation ?
Pour bien manger et prendre soin de notre santé, il est important de :
- Suivre les bases de la nutrition : éviter le tabac, limiter l’alcool et surveiller l’excès de sucre, sel et graisses.
- Choisir des produits frais et de qualité, en privilégiant ceux de saison et locaux, pour réduire l’impact écologique du transport.
- Manger bio, de préférence en circuit court, et connaître le producteur et ses pratiques.
Pourquoi consommer de saison ?
La consommation de produits importés toute l’année est non seulement mauvaise pour l’environnement (à cause du transport), mais aussi pour les aliments eux-mêmes (perte de nutriments et conservateurs). En mangeant de saison, on consomme ce qui est adapté à notre climat et à notre époque, ce qui est naturellement plus sain.
Des exemples d’aliments d’hiver
L’hiver offre une variété de fruits et de légumes comme les pommes, les poires, les poireaux, les carottes, les pommes de terre, les chicons, la betterave ou le topinambour. Les mois d’hiver ne sont donc pas pauvres en aliments, contrairement à ce que l’on pourrait croire.
Bio et local : un duo gagnant
Choisir entre bio et local n’a pas de sens, car les deux vont de pair pour garantir qualité et respect de la planète. Acheter bio, c’est s’assurer de consommer des produits sans pesticides. Acheter des produits locaux, c’est soutenir les producteur.trice.s de notre région tout en limitant l’impact écologique (notamment du transport) de nos aliments.
Manger, c’est aussi symbolique
Notre alimentation n’est pas qu’une question de nutrition. Nos choix alimentaires sont souvent influencés par des symboles sociaux, et ces choix peuvent avoir des effets durables sur notre santé.
Quelle différence entre le label Nature & Progrès et le reste du bio ?
Nature & Progrès va au-delà des critères de l’agriculture biologique standard en ajoutant une charte éthique qui couvre trois grands axes : écologique, économique et social.
- Écologique : cela inclut des critères sur l’énergie, le climat, l’eau, la biodiversité et le bien-être animal.
- Économique : l’accent est mis sur la résilience et l’équité.
- Social : cela concerne la préservation du patrimoine, des savoir-faire et le rôle nourricier de l’alimentation.
Chaque producteur.trice est invité à réfléchir à ces aspects et agir en conséquence dans son travail. Cette réflexion est régulièrement discutée lors des visites du Système Participatif de Garantie (SPG), où producteurs, représentants de l’association et consommateurs peuvent échanger.
La différence clé réside dans le fait que Nature & Progrès ne se contente pas de certifier un produit, mais « labellise » avant tout la personne derrière la production, en prenant en compte l’ensemble de son système de production. L’objectif est de promouvoir des pratiques agricoles et de transformation respectueuses de l’environnement, de l’économie et de la société.
Pour en savoir plus : https://www.natpro.be/producteurs-bio-natpro/nos-producteurs/
Soutenir Nature & Progrès, c'est agir !
Nature & Progrès est soutenue par des milliers de membres en Wallonie et à Bruxelles.
Cette communauté active et qui partage nos valeurs nous donne plus de poids dans nos actions quotidienne.
Envie d’y prendre part également ?