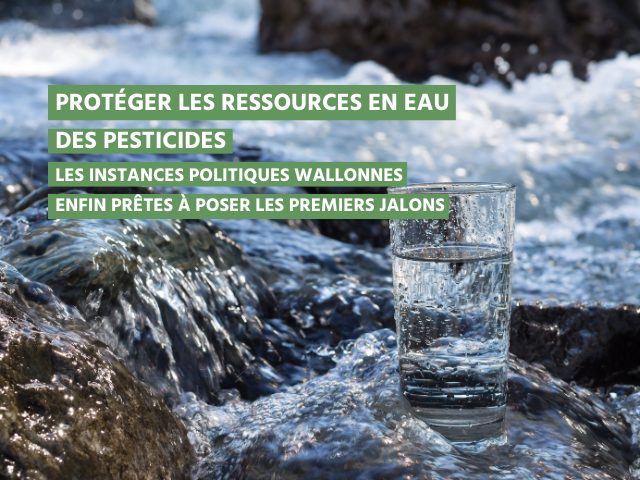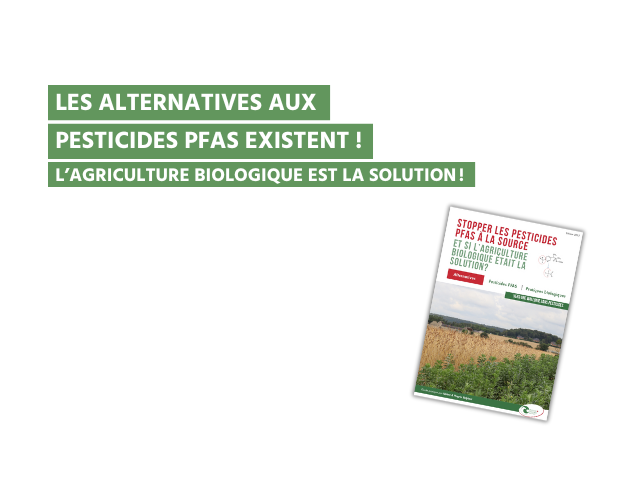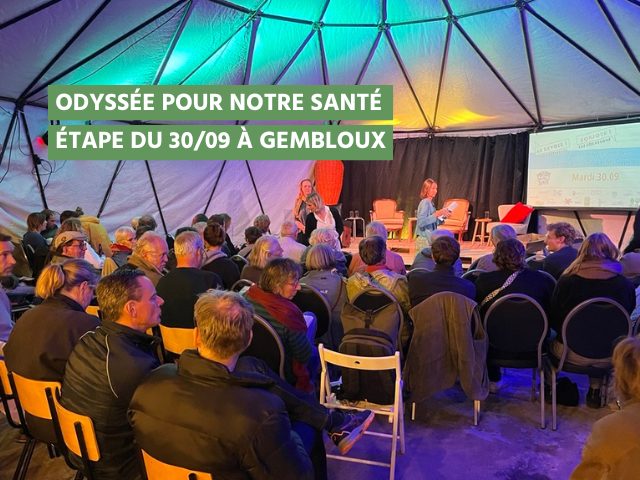Des pommes européennes contaminées par des cocktails de pesticides (PFAS, neurotoxiques et autres substances hautement toxiques)

© Adobe Stock, tous droits réservés
29 janvier 2026
Communiqué de presse
L’analyse de résidus en pesticides de 59 pommes en Europe met en évidence une contamination quasi systématique avec un cocktail de pesticides. Bien que la loi le prévoie, l’UE n’évalue toujours pas la toxicité liée à l’exposition des consommateurs à des mélanges de pesticides. L’enquête révèle aussi que si ces pommes avaient été destinées à des aliments transformés pour bébés, elles n’auraient pas été autorisées à la vente.
A l’heure où la Commission européenne propose une législation « omnibus »[1] visant à réduire le niveau de protection de la santé des citoyens et de l’environnement, PAN Europe et 13 organisations membres, dont Nature & Progrès, publient les résultats d’une enquête sur la contamination d’un des fruits les plus courant consommé par la population belge, les pommes. L’analyse de résidus de pesticides dans ces fruits, issus de l’agriculture dite conventionnelle, en provenance de 12 pays de l’UE et la Suisse révèle une contamination quasi systématique (85%). Ce rapport démontre qu’une réglementation plus stricte de la mise sur le marché des pesticides est nécessaire, et non l’inverse.
« L’un des résultats les plus frappants est que 85 % des pommes testées contenaient plusieurs résidus de pesticides. L’Autorité européenne de sécurité des aliments a été chargée il y a 20 ans de développer une méthodologie pour prendre en compte l’exposition aux mélanges de pesticides. Mais à ce jour, une telle analyse fait toujours défaut, exposant gravement la santé des européens.» déclare Gergely Simon, chargé de campagne chez PAN Europe.
L’étude pointe aussi le fait que 71 % des pommes analysées contenaient au moins un résidu appartenant à la catégorie européenne des pesticides les plus toxiques, « les candidats à la substitution (CFS) ». Tandis que 64 % des échantillons contenaient au moins un pesticide PFAS et 36 % un pesticide neurotoxique. L’étude relève également le fait que seules 4 pommes parmi les 59 analysées seraient autorisées à la consommation pour les bébés si les critères de présence de résidus dans les produits transformés (purées, compotes, … ) s’appliquaient aux produits frais.
« Pour les enfants de moins de trois ans, la réglementation européenne adopte une approche de précaution et fixe des limites strictes pour les résidus de pesticides dans les aliments transformés, afin de protéger leur développement. Les jeunes parents ne savent pas que nourrir leurs enfants avec des fruits ou légumes frais conventionnels plutôt que des produits transformés augmente en réalité leur exposition aux pesticides. Il est inacceptable que les autorités publiques belges et européennes ne fassent aucune campagne d’information et de promotion de l’alimentation biologique, particulièrement pour les jeunes enfants et les femmes enceintes.» déplore Virginie Pissoort, responsable de plaidoyer pour Nature & Progrès.
Parmi les 59 pommes européennes analysées, 4 proviennent de Belgique. Trois sur quatre contiennent des résidus de pesticides au-dessus des limites de quantification et la moitié contenait un cocktail d’au moins trois pesticides. Deux sur quatre contenaient des résidus de pesticides neurotoxiques, et une sur quatre, des résidus de pesticides PFAS. Seul une pomme était propre à la consommation pour les bébés, si la même norme restrictive pour les produits transformés était applicable aux produits frais.
En décembre 2025, la Commission européenne a proposé de déréglementer les pesticides en supprimant l’obligation de réévaluer leur toxicité tous les 10 à 15 ans, ouvrant ainsi la voie à des autorisations sans limite de durée. Elle suggère également de permettre aux États membres d’écarter les données scientifiques les plus récentes lors de l’évaluation de ces substances. Nature & Progrès et PAN Europe et tous ses membres s’opposent à cette proposition et plaident pour une application plus stricte des règles existantes ainsi qu’une meilleure protection de la santé des citoyens et de l’environnement.
Lire le rapport complet en version originale en anglais et en français ICI.
Fact sheet par pays : ici
[1] https://www.natpro.be/actus/pesticides/omnibus-vii-la-commission-europeenne-maintient-son-plan-initial-dautorisation-a-duree-illimitee-de-certains-pesticides-au-prejudice-de-la-sante-et-de-lenvironnement/