Cet article est paru dans la revue Valériane n°174
***

Par Jean-Louis Van Malder,
membre chez Nature & Progrès
Nos sols sont indispensables à la vie. A partir d’une meilleure compréhension de leur fonctionnement global et de leurs besoins, réfléchissons aux bonnes pratiques à mettre en œuvre au jardin pour préserver, voire enrichir notre terre nourricière.

Dépôt de matières organiques entre les cultures
Peu de personnes, questionnées sur les éléments indispensables à notre vie d’humain, mentionnent immédiatement le rôle des sols vivants dans notre approvisionnement en air, en eau et en aliments. Tellement accessibles. Tellement allant de soi. Pareillement, se pourrait-il que le sol, cette « chose » foulée des pieds, non seulement soit vivante, mais nécessite désespérément les mêmes éléments pour pouvoir remplir des fonctions cruciales dont dépendent toutes les formes de vie sur terre, humaines et non-humaines ? A tel point que le microbiote des sols s’avère semblable à notre propre microbiote, notre flore intestinale, notre système immunitaire et notre cerveau.
Prendre soin de nos « ingénieurs » des sols
Comment le jardinier bienveillant peut-il veiller à ce que la dynamique de « son » sol fonctionne au mieux des exigences des différents cycles auxquels il contribue ? Rappelons-nous que les êtres microscopiques et macroscopiques vivant dans le sol sont d’excellents recycleurs des matières organiques présentes dans la litière et immédiatement en-dessous de son niveau. Pour effectuer cette perpétuelle métamorphose en nutriments assimilables pour les plantes et les arbres, ils transforment eux-mêmes leur espace de vie minéral pour que l’air et l’eau puissent y circuler. En d’autres mots, ces ingénieurs du sol, lombrics en tête, veillent à structurer les sols en agrégats poreux et à fournir l’alimentation et l’ancrage du brin d’herbe comme de l’arbre imposant.
Eviter le compactage
De là, émerge la première préoccupation du jardinier : éviter le compactage du sol qui empêche la circulation fluide de l’air et de l’eau. La seule pression du pied sur un sol mouillé peut obturer les pores du sol et empêcher cette circulation. Que dire, dès lors, du passage d’une machine, du dépôt d’une palette de matériaux, du va-et-vient du bétail, de l’entreposage de matériel désaffecté ? Les sols réputés « lourds », argileux, sont les plus sensibles au phénomène. Alors avant de s’y engager par circonstances adverses, pensez à répartir la pression exercée sur le sol en vous déplaçant sur une planche ou sur une surface rigide, ou en préférant le travail d’engins sur chenilles plutôt que sur pneumatiques. Cette précaution évitera un compactage du sous-sol, très difficile – voire impossible – à corriger. De manière spontanée, un sol tassé se révèlera d’une part, par l’apparition d’une végétation naturelle pionnière – du genre prêle, chiendent, renoncules, plantain, liseron dont les racines profondes aident à réaménager le sous-sol – et, d’autre part, par l’aspect malingre des cultures exposées, de ce fait, à toutes les prédations.

Paillage de tontes entre les plants
Assurer une bonne couverture
Evidemment, le jardinier consciencieux peut de surcroit venir en aide aux recycleurs et ingénieurs des sols en leur facilitant la tâche par un apport régulier de matières organiques en surface, sous forme d’herbes fauchées ou tondues, de compost, de feuilles mortes, de broyats issus de branches taillées, de foin ou d’un engrais vert. Un sol vivant ne pourrait jamais se trouver dépourvu de végétation vivante ou en décomposition, exposé aux intempéries de plus en plus extrêmes. Privée de couverture, la surface du sol risque la battance des pluies (déstructuration et compactage), l’asphyxie, l’érosion des particules fines d’argiles entraînées vers les égouts, les rivières et, in fine, les océans, avec tous les dangers de pollutions, d’inondations que ce phénomène représente. Appauvrissement, fragilisation, acidification… Une évolution peu enviable qui peut mener à la désertification.
Respecter les couches
En revanche, un sol couvert en permanence d’une végétation diverse en niveaux de croissance et en espèces, où l’air et l’eau circulent suffisamment, invitera les lombrics, les mille-pattes, les limaces, les coléoptères, les cloportes, les fourmis, à travailler d’arrache-pied, surtout si ces organismes trouvent, en plus de cette couverture, une litière formée en sous-sol par les racines, leurs exsudats, les champignons et les bactéries. Dès lors, il apparait clairement que les travailleurs de l’ombre n’aiment pas voir leurs horizons bouleversés par un travail de bêchage ou de hersage en profondeur. A chaque strate sa population, et le sol fonctionnera au mieux de ses possibilités. Evidemment, dans certains cas, un bêchage ou un défoncement du sol peut être envisagé, notamment pour établir une plate-bande de plantes vivaces ou pour pratiquer un faux semis avant une culture. Dès ces préliminaires effectués, il vaudrait mieux que les différentes couches du sol ne soient plus mélangées.

Une couche de miscanthus en protection d’hiver
Refuser la chimie
Le temps de jouer à l’apprenti sorcier se trouve définitivement révolu. L’utilisation de produits chimiques de synthèse – herbicides, fongicides, insecticides – ne trouve jamais de justification soutenable. Même l’utilisation de paille provenant de céréales produites par l’agriculture conventionnelle ou de rouleaux de gazon parfaitement exempts d’adventices devraient engager la suspicion et la prudence.
Toute la magie opérée en permanence par les organismes visibles et invisibles du sol s’est affinée au cours d’une longue et patiente évolution pour devenir ce que l’on trouve encore dans les forêts préservées. Dans l’espace de temps de l’humain, il revient aux jardiniers d’approcher cet univers avec humilité et cohérence, avec un savoir-faire – ou plutôt un savoir-vivre -indéfectible.
Aller plus loin…
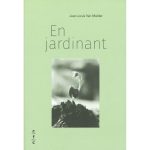
Découvrez l’ouvrage « En jardinant » écrit par Jean-Louis Van Malder, publié aux éditions CFC. Au fil des pages, vous serez entraîné dans les aventures et dans les réflexions de l’auteur lors de l’aménagement de son jardin et de l’évolution, au fil des années, de ses cultures. A découvrir à la librairie écologique de Nature & Progrès (285 pages, 28 euros – 10 % de réduction pour les membres).
Cet article vous a plu ?
Découvrez notre revue Valériane, le bimestriel belge francophone des membres de Nature & Progrès Belgique. Vous y trouverez des
informations pratiques pour vivre la transition écologique au quotidien, ainsi que des articles de réflexion, de décodage critique sur nos enjeux de
société. Découvrez-y les actions de l’association, des portraits de nos forces vives, ainsi que de nombreuses initiatives inspirantes.
En devenant membre de Nature & Progrès, recevez la revue Valériane dans votre boite aux lettres. En plus de soutenir nos actions,
vous disposerez de réductions dans notre librairie, au Salon bio Valériane et aux animations proposées par nos groupes locaux.