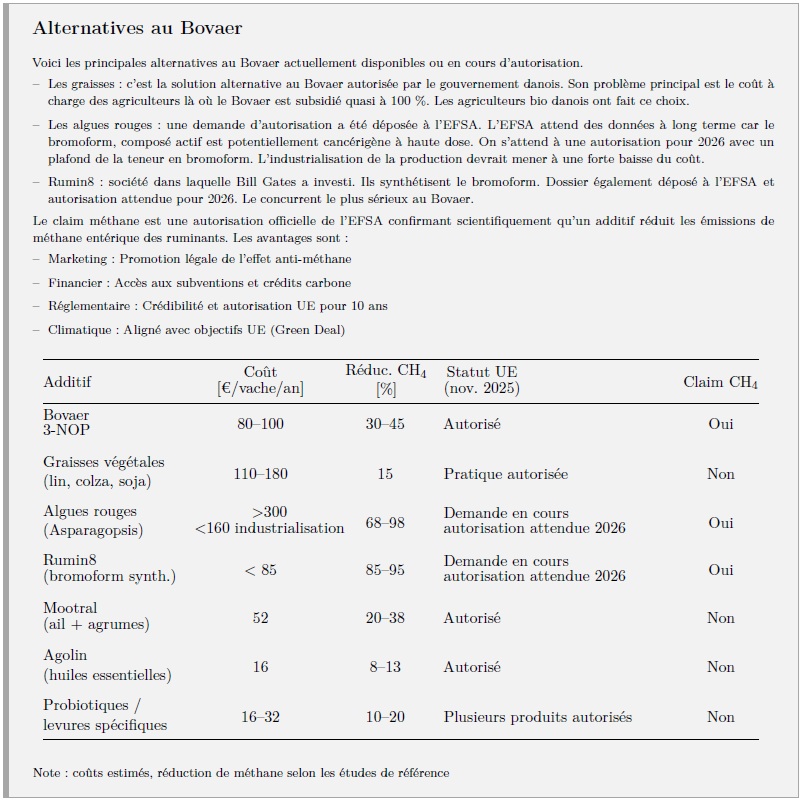Quand élevage rime avec biodiversité
Cette analyse est parue dans la revue Valériane n°177
***

Par Thibaut Goret,
éleveur bio sous mention Nature & Progrès,
et Sylvie La Spina,
rédactrice en chef
chez Nature & Progrès
« Mangez moins de viande », entend-on de plus en plus souvent de la bouche des acteurs préoccupés par l’environnement. « Mangez du bœuf bio à l’herbe », répondons-nous, chez Nature & Progrès. L’élevage bio extensif basé sur les fourrages de la ferme est une clé de la préservation des prairies naturelles, havres de biodiversité et puits de carbone en faveur du climat.

Prairie à succise et à sélin, deux espèces indigènes rares
A la question « Quels sont les impacts de l’élevage sur la biodiversité ? », on entend le plus souvent parler de la déforestation, de la pollution de l’eau et des sols et des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au dérèglement climatique. L’idée d’une activité polluante et nocive pour l’environnement est largement répandue. « Arrêtez de manger de la viande », hurlent les tenants du véganisme. « Mangeons moins de bœuf », proposent les plus modérés et quelques scientifiques. Parce que nos bovins, comme nos chèvres et moutons, en bons ruminants, émettent via leurs éructations du méthane, un gaz à effet de serre puissant. On ferait alors d’une pierre plusieurs coups : en réduisant les surfaces consacrées à l’élevage de ruminants, on augmenterait la part des cultures destinées à l’alimentation humaine. Moins de pollution, moins de gaz à effet de serre, moins de consommation d’eau, plus de biodiversité, plus de nourriture. Et si cette vision était un peu trop simpliste ?
De fausses bonnes idées
L’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement français (INRAE) a publié un condensé des idées fausses sur la viande et l’élevage[i]. Les chercheurs y pointent généralisations abusives et simplifications qui ponctuent les discours. Prenons un seul exemple bien illustratif : les fameux 15.000 litres d’eau consommés pour produire un kilogramme de viande. Ils comprennent l’eau bleue (abreuvement et irrigation des cultures), l’eau grise (dépollution et recyclage des effluents) et l’eau verte, eau de pluie arrosant les parcelles destinées à nourrir les animaux. Cette dernière, représentant 95 % de cette empreinte eau, est captée dans les sols et évapotranspirée par les plantes. Dans le contexte français proche du nôtre, il faudrait compter, en eau réellement consommée, 20 à 50 litres seulement.
Dans le rayon des fausses bonnes idées, on trouve celle que « supprimer l’élevage réduirait le gaspillage de ressources et la compétition avec l’alimentation humaine ». L’INRAE a calculé que 86 % de la ration moyenne mondiale est composée d’aliments non consommables par l’homme. On y trouve 70 % de fourrages et 16 % de résidus et coproduits de culture (sons, tourteaux…). Que dire de nos élevages en autonomie fourragère, misant sur l’herbe ? Enfin, la question de l’utilisation du sol mérite le détour. « Le sol serait mieux utilisé pour la culture de végétaux que pour l’élevage d’animaux », entend-on couramment. C’est malheureusement croire que tous les sols sont identiques, ce qui est loin d’être le cas. Nos campagnes montrent une gradation des modes d’utilisation des terres en fonction de leur fertilité : les plus pauvres, pentues ou superficielles sont occupées par la forêt, les intermédiaires, par les prairies permanentes, et les plus riches, par les cultures. L’espace occupé par les prairies pâturées ou fauchées destinées à nourrir les ruminants est majoritairement constitué de terres non cultivables.
Des prairies réservoir de biodiversité
Justement, parlant environnement, les prairies naturelles – qui ne sont pas labourées et semées – représentent un habitat prioritaire pour la biodiversité. Si la forêt est souvent la première image qui vient en tête lorsque l’on évoque la nature étant donné qu’elle semble plus sauvage, moins influencée par les humains – le cycle des arbres étant beaucoup plus long que celui des cultures agricoles -, c’est dans les prairies naturelles que l’on rencontre la plus importante diversité d’êtres vivants, et le nombre le plus important d’espèces menacées.
Réservoir d’espèces animales et végétales absolument extraordinaire, les prairies naturelles sont les seules surfaces agricoles constituées entièrement d’une flore sauvage et indigène. Une prairie de haute valeur biologique peut abriter jusqu’à 80 espèces végétales sur un are. Comment expliquer une telle richesse ? La combinaison entre les caractéristiques physiques et chimiques du sol (teneur en éléments minéraux, humidité, acidité, texture…) et la gestion du milieu (fauche, pâturage, fréquence des coupes, charge en bétail…) offre à la Wallonie une diversité exceptionnelle de type de prairies. En phytosociologie, discipline botanique qui étudie les communautés végétales, on dénombre une vingtaine d’écosystèmes ayant chacun leur cortège floristique propre. Pelouses calcaires, mégaphorbiaies (friches humides), prairies humides oligotrophes (pauvres en éléments nutritifs), landes, praires maigres de fauche, pâtures maigres… en sont quelques exemples.
L’indispensable action de l’homme
Il est primordial de comprendre que les prairies naturelles sont bien des milieux agricoles : elles nécessitent une gestion par l’homme, par fauche ou par pâturage. Sans cette intervention, sous nos latitudes, elles seraient naturellement colonisées par la forêt, ce qui verrait disparaître les espèces spécifiques de ces milieux ouverts. L’élevage d’animaux herbivores (vaches, moutons, chèvres, buffles, bisons…) est donc un maillon essentiel pour la préservation de la biodiversité. Il façonne nos paysages depuis plus de 8.000 ans. La flore et la faune sauvages ont co-évolué avec les pratiques agro-pastorales ancestrales, permettant l’expression d’une richesse biologique hors du commun. Voici un magnifique exemple d’alliance entre agriculture et nature.
Ce partenariat fut bénéfique jusqu’à la révolution verte. Vers le milieu du 20e siècle, de nombreuses prairies ont été urbanisées, labourées, recolonisées par la forêt ou plantées d’arbres résineux, en grande majorité. Depuis 1955, un tiers des prairies permanentes de Wallonie (plus de 200.000 hectares) ont ainsi disparu. Par ailleurs, sur les herbages restants, les pratiques agricoles se sont intensifiées : usage d’engrais chimiques, drainage, précocité et fréquence des coupes (ensilage et préfané rendus possible par l’usage du plastique) et augmentation de la charge en bétail. Tous ces facteurs ont contribué à une homogénéisation du milieu et à diminuer drastiquement la diversité floristique et faunistique. En Wallonie, sur les 350.000 hectares de prairies actuels (permanentes et temporaires), seulement 25.000 ha (7 %) sont considérés comme riches en biodiversité.
Si les espèces sauvages en milieu agricole se portent mal, voire très mal, que dire du monde agricole dont la population s’effondre littéralement, passée de 120.000 agriculteurs début du siècle dernier à 12.000 actuellement. Le lien de cause à effet est évident : plus leur nombre décroit, plus la diversité des pratiques s’estompe, plus le paysage se simplifie, plus la diversité des espèces diminue… Cette observation rejoint le constat du sociologue Léo Magnin (lire notre étude sur les arbres), qui interroge l’avenir de l’entretien des haies, et plus globalement, de la biodiversité en milieu agricole, étant donné la raréfaction des agriculteurs et les surfaces de plus en plus importantes que chacun a à gérer.
Des mesures de protection
Plusieurs mesures ont été mises en place pour préserver les milieux semi-naturels et encourager les agriculteurs à adapter leurs pratiques de gestion. Le réseau Natura 2000 protège 38.000 hectares de prairies permanentes, soit un peu plus de 10 % des prairies wallonnes. Une partie est interdite d’intensification (fauches tardives et diminution ou interdiction d’engrais organique en UG3 et UG2 respectivement). Parmi les BCAE (Bonnes Conditions Agricoles et Environnementales) de la nouvelle Politique agricole commune (PAC), la BCAE1 interdit une diminution de plus de 5 % des prairies permanentes dans la surface agricole régionale, et la BCAE2 interdit la conversion de prairies permanentes dans différentes situations (sols tourbeux ou saturés en eau, zones d’aléas d’inondation élevés, etc.). Comme règle indirecte dans la nouvelle PAC, il existe un seuil de 75 % de prairies permanentes par ferme au-dessus duquel les agriculteurs sont dispensés d’une série de règles, les incitant donc à leur maintien. Les MAEC (Méthodes Agri-Environnementales et Climatiques), mesures concernant l’agriculture biologique, la prairie naturelle, la prairie de haute valeur biologique et l’autonomie fourragère (ou faible charge en bétail), existant toutes depuis plus de 20 ans, sont des outils très puissants pour conserver l’intérêt biologique des prairies via une gestion adaptée. Les projets PwDR (Plan wallon de développement rural) et Life sont des leviers formidables pour restaurer des milieux ouverts semi-naturels à partir de forêts résineuses ou de prairies intensives. En termes de conservation, il est essentiel de continuer à créer des réserves naturelles, statut de protection le plus fort en Wallonie. Parmi celles-ci, environ 2.000 hectares sont des milieux ouverts gérés par Natagora en partenariat avec plus de 300 agriculteurs wallons. Avec 1.000 hectares supplémentaires par an sous la législature précédente, la Wallonie vient de passer le cap d’un pourcent. Sachant que la communauté scientifique est unanime pour dire qu’il faut minimum 5 % (idéalement 10 %) d’aires protégées pour assurer le bon état de fonctionnement de nos écosystèmes et la survie de l’humanité, il y a encore du chemin à parcourir !
Quand élevage rime avec bocage…
L’élevage est de plus en plus perçu comme un ennemi de l’environnement, étant donné les émissions de gaz à effet de serre produits par les ruminants. C’est oublier le rôle déterminant de ces animaux dans l’entretien des herbages qui contribuent au stockage de carbone atmosphérique. C’est oublier aussi le rôle des fumiers dans la fertilité des sols. En outre, l’élevage, lorsqu’il est biologique et extensif (faible charge en bétail[ii], à l’herbe), permet la valorisation de surfaces agricoles non cultivables qui ne pourraient pas produire de protéines (lait et viande) autrement, et la préservation de milieux semi-naturels d’une biodiversité devenue rare aujourd’hui. De plus, ces fermes aux pratiques vertueuses assurent une série de services écosystémiques supplémentaires comme la préservation de la qualité des eaux de surface et souterraines. Et, comme le développait Claude Aubert dans une de nos analyses, ces élevages biologiques en autonomie fourragère captent davantage de carbone qu’ils n’en émettent. La crise frappe de plein fouet le secteur agricole. C’est la fin de la parenthèse dorée où le pétrole était abondant et bon marché. Le renouvellement des générations d’agriculteurs est reconnu comme un enjeu prioritaire.
« Mangeons de la viande de bovins bio issus d’élevages extensifs », nuancerons-nous donc face aux injonctions courantes tentant de mieux associer alimentation et environnement. Il est urgent de promouvoir, inciter et soutenir la transition agroécologique, seule issue viable, vivable et équitable. Pour notre santé et celle de la Terre.
La Ferme des Reines des Prés
Ingénieur agronome, Thibaut s’évertue, depuis le début de sa carrière professionnelle, il y a 20 ans, à lutter pour la préservation des prairies naturelles et leur restauration. Ce, d’abord comme conseiller MAEC puis comme coordinateur du projet LIFE « Prairies bocagères » et actuellement, à mi-temps sur la transition agro-écologique du Parc national de l’Entre-Sambre-et-Meuse. En parallèle, depuis 2017, Thibaut élève une soixantaine de bovins de race Parthenaise à Beauraing, où il entretient environ 50 hectares de prairies dont 40 % reconnues de haute valeur biologique. Une riche biodiversité co-existe avec ses pratiques d’élevage extensif, dont le triton crêté, la pie-grièche écorcheur et le grand rhinolophe, des espèces menacées. Thibaut propose régulièrement des colis de viande à la ferme. Infos : parthenaisesfamenne@gmail.com
REFERENCES
[i] Mollier P. Quelques idées fausses sur la viande et l’élevage. 19 décembre 2019. https://www.inrae.fr/actualites/quelques-idees-fausses-viande-lelevage
[ii] Des études scientifiques démontrent le lien entre faible charge en bétail et diversité biologique. Voir par exemple « Etude de l’effet de la charge en bétail sur la valeur biologique des prairies » par Goret Th., Halford M., Jacquemart A-L. et Lambert R. (2008, Journées AFPF). https://share.google/b1GYqlB9T4YJMWxT1
[iii] La Spina S. 2023. Soixante années d’évolution de l’agriculture biologique. Valériane 164 : 25-27. https://www.natpro.be/analyses/soixante-annees-devolution-de-lagriculture-biologique/
Cet article vous a plu ?
Découvrez notre revue Valériane, le bimestriel belge francophone des membres de Nature & Progrès Belgique. Vous y trouverez des
informations pratiques pour vivre la transition écologique au quotidien, ainsi que des articles de réflexion, de décodage critique sur nos enjeux de
société. Découvrez-y les actions de l’association, des portraits de nos forces vives, ainsi que de nombreuses initiatives inspirantes.
En devenant membre de Nature & Progrès, recevez la revue Valériane dans votre boite aux lettres. En plus de soutenir nos actions,
vous disposerez de réductions dans notre librairie, au Salon bio Valériane et aux animations proposées par nos groupes locaux.